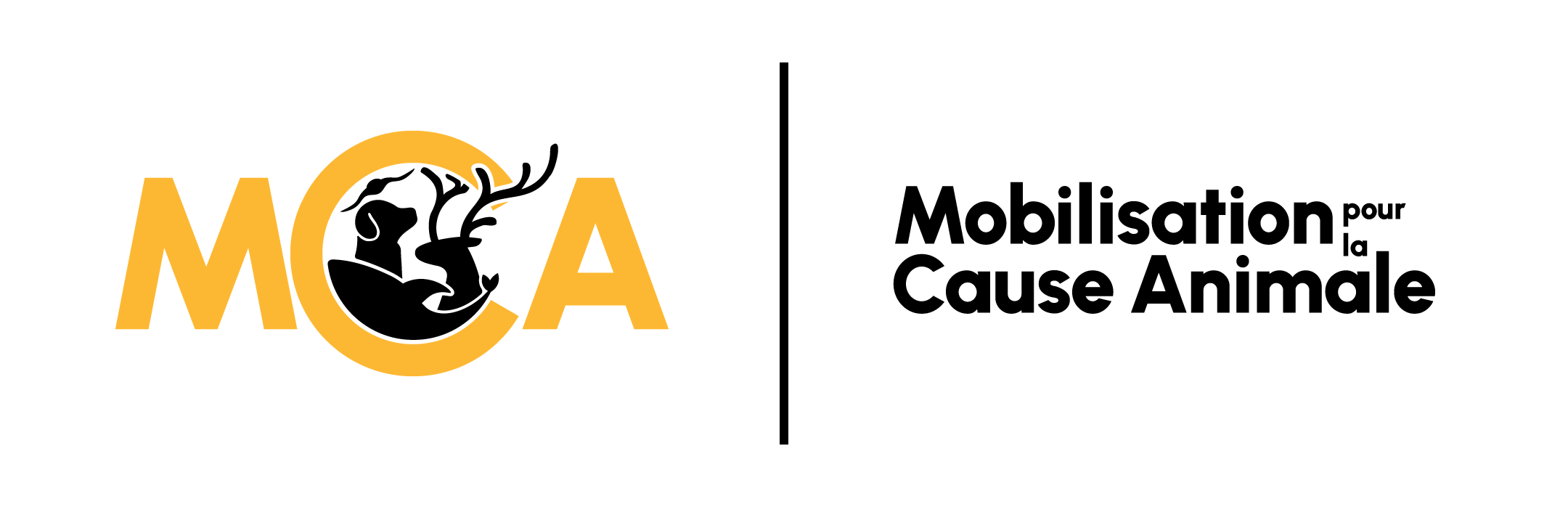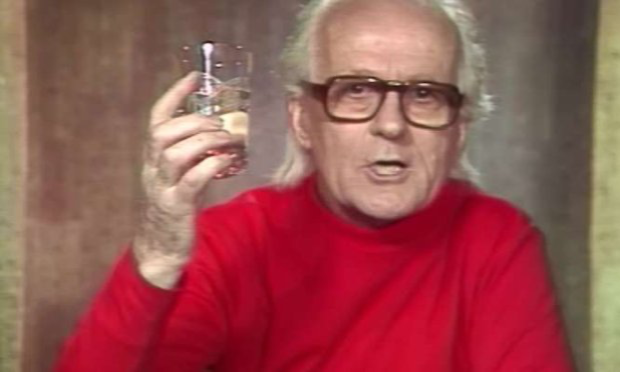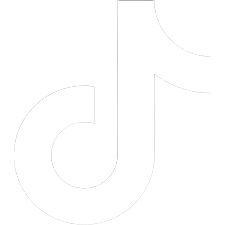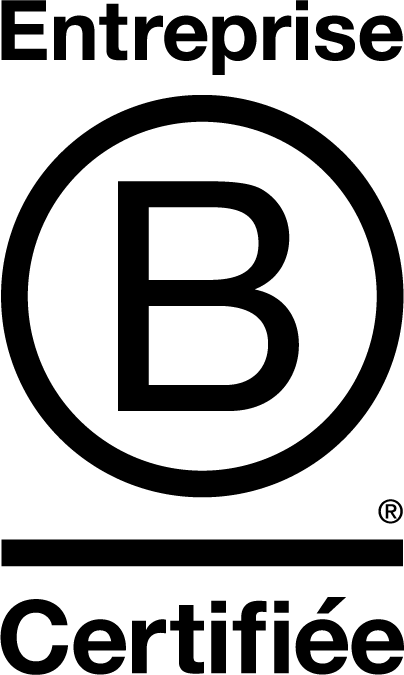07/02/2024
7 février 2024
Il y a un demi-siècle, René DUMONT, devenu le premier candidat écologiste à l’élection présidentielle française, prononça solennellement son discours de candidature le 19 avril 1974 dont le Grand public a retenu cette phrase-culte : « Nous allons bientôt manquer de l’eau. Et c’est pourquoi je bois devant vous un verre d’une eau précieuse puisqu’avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, cette eau manquera ».
Qu’avons-nous pu entreprendre depuis 50 ans pour préserver l’eau, l’un de nos biens communs, face aux gaspillages et aux pollutions dus à certains systèmes agricoles hyper-productivistes ? Pas grand-chose car dès les années 1980 le ministère de l’agriculture, en connivence avec la FNSEA, s’est approprié les modalités de lutte dans ces secteurs d’activités. Récemment, le ministre de l’agriculture, Marc FESNEAU, nous a gravement induit en erreur en justifiant de sacrifier la qualité de l’eau souterraine au nom de la "souveraineté alimentaire", donc au nom de productions agricoles censées nourrir les habitants. Cette interprétation est erronée car le ministre a agi pour défendre l’agriculture exportatrice dans le cadre de la mondialisation néo-libérale, des échanges commerciaux et de l’équilibre de la balance commerciale, appuyant fort sur la nécessité de la compétitivité. Confirmant son attitude, le ministre a carrément annoncé le 22 janvier 2024, lors de son déplacement en Vendée, qu'il compte accélérer le développement de retenues d'eau, les "super-bassines" pourtant si dévastatrices pour la gestion durable de l’eau.
Ces gigantesques super-bassines ne sont en effet destinées qu’à de grosses exploitations agricolo-industrielles, appuyées par leurs coopératives, comme la Coopérative de l’eau 79, qui cultivent sur d’immenses parcelles des plantes goulafres d’eau durant la période la plus sèche de l’année, en juillet et août, notamment le maïs, une plante dont la France est la première exportatrice européenne !
Nous sommes très loin de la souveraineté alimentaire mise en avant. Nous sommes face à un système agro-industriel qui gaspille l’eau, pollue l’eau, tue les sols, affecte la biodiversité, altère la santé, un système qui va totalement à l’encontre des missions des Agences de l’eau.
Les Agences de l’eau ont hélas apporté leurs aides à ces activités économiques qui gaspillent l’eau sans vergogne pour des cultures d’exportation. Elles doivent absolument retrouver leur véritable mission qui est de soutenir des actions favorables à la santé, au cadre de vie, à la préservation de la ressource en eau et à la biodiversité". En ont-elles encore la possibilité ?
Les six Agences de l’eau créée par La Loi du 16 décembre 1964 sont des instruments au service des usagers de l’eau et constituent un système basé sur le principe démocratique de la participation des usagers de l’eau au processus décisionnel dans le domaine de la politique de l’eau, grâce à la création des comités de bassin, des instances délibératives qui constituent de véritables "parlements locaux de l’eau" et dans lesquels sont rassemblées toutes les parties prenantes concernées.
Dans l’exercice quotidien de leurs missions, les agences de l'eau sont gérées par un directeur et par un Conseil d'administration dont le président est le préfet coordonnateur du bassin, nommé par un décret du président de la République, lui-même en lien avec les préfets des départements du bassin. Sous l’autorité de ce préfet, le Conseil anime la politique de l’État en matière de gestion des ressources en eau, approuve le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) élaboré par le Comité de bassin, participe au contenu des programmes d’actions et notamment de son programme d'intervention pour 6 ans, décide du budget de l’agence et de l’attribution des aides financières aux personnes publiques ou privées, fixe les taux des redevances et les règles d’attribution des aides.
De fait, les Agences de l’eau ne sont plus vraiment libres de leurs décisions depuis que le Parlement français a repris la main sur les Agences avec la Loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) qui fixe désormais les plafonds des redevances antérieurement décidés par les usagers de l’eau.
Ainsi durant l’été 2023, lors de l’arrêt du collectif "Convoi de l’eau" à Orléans au siège de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, c’est la Préfète de bassin, Sophie BROCAS, qui en tant que Présidente du Conseil d’administration de l’Agence et en coordination avec les ministères, a négocié avec le collectif pour finalement refuser le 25 août 2023 le moratoire sur les super-bassines demandé par les manifestants, snobant le souhait de dialogue des responsables de l’Agence qui ne sont pas dupes des malversations des exploitants agricoles hyper-productifs.
Tout récemment, dans un rapport du 12 décembre 2023, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a d’ailleurs dressé un bilan très critique de la première retenue de substitution en activité, la méga-bassine de Mauzé-sur-le-Mignon, en service depuis février 2022, qui avait pourtant fait l’objet du protocole d’accord du 18 décembre 2018dans lequel les irrigants qui y sont raccordés s’engageaient à une transition vers des pratiques agroécologiques. L’Agence constate que les objectifs affichés sont jugés peu ambitieux et elle alerte sur ce manque d’ardeur des exploitants jugé comme un signal très négatif alors que la mise en œuvre du protocole d'accordne fait que démarrer et que la réalité de l’évolution des pratiques agricoles est très contestée.
Comment les Agences de l’eau peuvent-elles reconquérir l’autonomie de leur mission initiale qui est d’agir sur la santé, le cadre de vie, la préservation de la ressource en eau et la biodiversité, comment peuvent-elles reprendre la main sur leurs redevances, notamment agricoles, quand c’est l’Etat qui prend les décisions à leur place ?